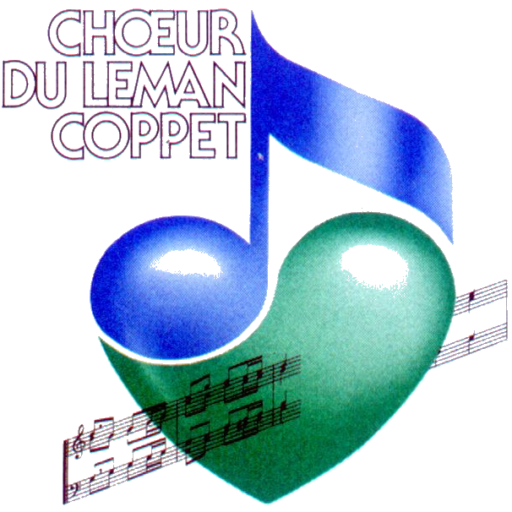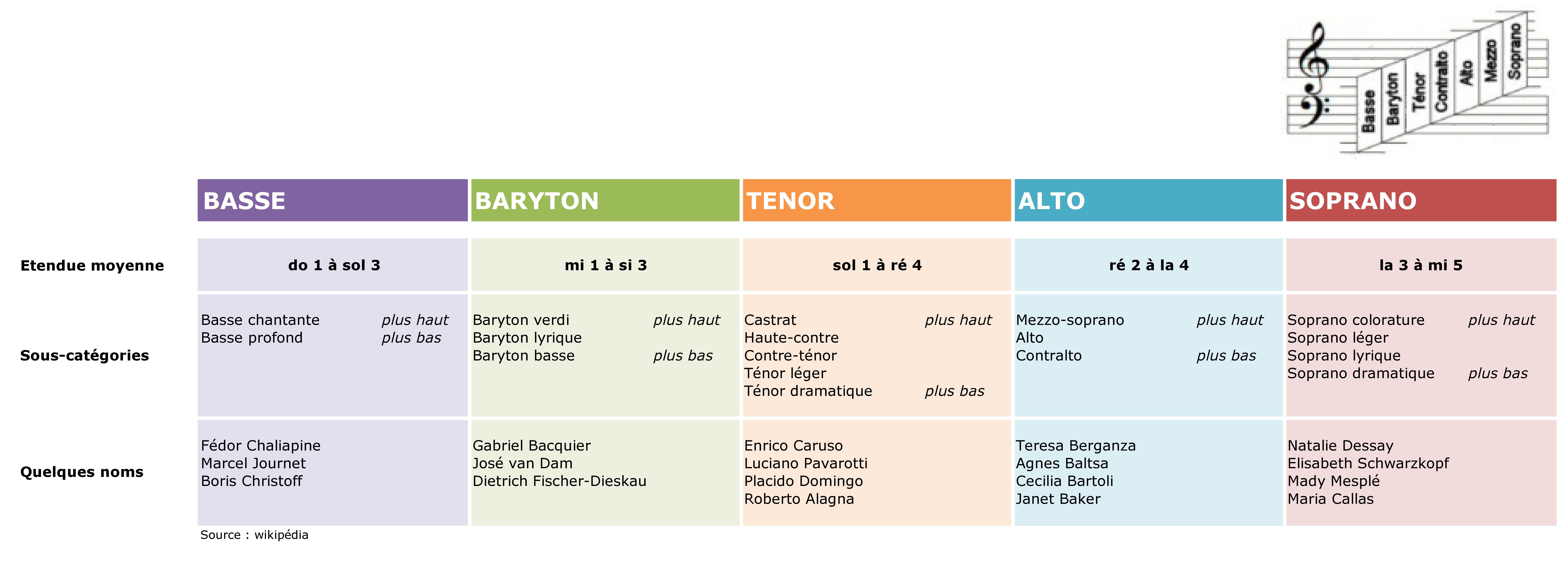Chœur du Léman ∙ Coppet
Chœur du Léman ∙ Coppet
Chœur d’hommes fondé en 1860
La voix
Définition
Du grec ancien Xopoç, choros, il s’agissait dans la haute Antiquité grecque de danse de cérémonial ou de danseur cérémonieux. Puis, ce fut un petit groupe d’hommes masqués et chargés de commenter la dramaturgie dans l’orchestra du théâtre antique.
Transféré à l’opéra avec l’apport des voix de femme, dans un premier temps le chœur prend rarement part à l’action, se chargeant de l’illustrer et de la contraster. Au cours du XVIIIe siècle, le chœur est de plus en plus intégré au drame, depuis les opéra de Gluck, Lully, Rameau jusqu’à l’opéra du XIXe siècle où les chœurs entrent en discussion avec les solistes et prennent leur parti dans les différentes situations, faisant souvent progresser l’action. De petits rôles sont aussi parfois attribués à un ou plusieurs choristes.
Aujourd’hui, le chœur est habituellement divisé en quatre pupitres principaux (soprano, alto, ténor et basse), chaque pupitre comportant ses propres divisions. Le nombre de choriste dépend de l’envergure de l’œuvre ou de la situation donnée. Par ailleurs le chœur peut être indépendant de l’opéra et se donner en concert (ex : les Chœurs de l’Armée rouge) dans un répertoire non obligatoirement d’opéra (oratorio, variété, gospel, etc.). Certaines formations sont uniquement composées d’hommes, de femmes ou d’enfants
Ensemble vocal
Un chœur désigne tout d’abord un ensemble musical, de nature exclusivement vocale, dont les membres, appelés choristes, chantent collectivement les différentes parties musicales destinées à ce type de formation la direction d’un chef de chœur. Dans ce sens, le mot » chœur » est souvent synonyme de chorale. Le concept de chœur s’oppose donc à celui d’ensemble de solistes.
Dans la musique sacrée, le chœur, qui est à l’origine une formation musicale religieuse, doit son nom à la place qu’il occupait traditionnellement dans l’église.
Selon l’âge et le sexe des choristes, on distinguera le chœur d’enfants, le chœur d’hommes, le chœur de femmes, ou encore, le chœur mixte – voix aigues et voix graves assemblées.
Les membres d’un chœur peuvent être répartis en plusieurs groupes, appelés pupitres ou voix. Ces divers groupes sont destinés à interpréter autant de parties musicales différentes.
Un chœur mixte comprend le plus souvent quatre pupitres, deux pupitres féminins, soprano et alto et deux pupitres masculins, ténor et basse. Ce type de chœur est appelé SATB. Selon le type de formation, on peut trouver un nombre inférieur ou supérieur à quatre pupitres. Lorsqu’il n’y en a qu’un seul, tout le chœur chante alors à l’unisson.
On peut avoir affaire à de de grosses ou très grosses formations, plus de cent choristes, à des formations de moyenne importance, entre trente et cent choristes ou à de petites formations de moins de trente choristes. Quels que soient le nombre de pupitres ou le nombre total de choristes, un ensemble vocal dans lequel chaque pupitre est tenu par un seul exécutant n’est plus un chœur, mais un ensemble de solistes.
Le chant
Le chant représente l’ensemble de la production de sons musicaux à l’aide de la voix. La personne qui produit le chant est appelée chanteur. Le terme s’étend aussi aux vocalisations et plus généralement aux signaux sonores émis par certains animaux dans un contexte de parade nuptiale (chant des oiseaux, chant des cigales…) ou non (chant des baleines).
Le chant résulte de l’action du souffle : l’air est expulsé des poumons par l’action du diaphragme, comme pour une expiration normale, et fait vibrer les cordes vocales. Le son ainsi produit est ensuite amplifié par les cavités naturelles (nez, sinus, cavités pharyngiennes, thorax), et éventuellement articulé par la langue et les lèvres pour former des syllabes.
En fait, le chant fait appel à toutes les ressources du corps humain : le système respiratoire est utilisé, mais aussi quantité de muscles aux fonctions les plus diverses, ceux du ventre, du dos, du cou, du visage. C’est d’ailleurs l’une des activités les plus complètes qui soit car elle exige une conscience du corps sur tous ces plans. On parle souvent d’ailleurs d’un entraînement musical et, dans une certaine mesure, un entraînement sportif, car, pour faciliter le travail de tous ces muscles – ouvrir la voie à l’air qui sort du corps et permettre aux poumons de se dilater au maximum -, il faut surveiller sa posture. » La cage thoracique doit être ouverte, les épaules rejetées en arrière et la colonne vertébrale bien droite. » Mais par-dessus tout, comme un entrainement sportif, le chant » exige un bon tonus musculaire et nous oblige à améliorer notre hygiène de vie – bien manger, faire de l’exercice, éviter le tabac, les excès d’alcool… – pour faire des progrès et les maintenir. «
Mais chanter ce n’est pas seulement se servir de sa voix et de son corps, c’est aussi interpréter, faire partager au public les émotions contenues dans le texte chanté : c’est en cela que, en fonction des genres musicaux sollicités, le chant rejoint fréquemment l’art de la scène.
- En musique classique, la voix est souvent utilisée comme un instrument de musique à part entière. Depuis plusieurs siècles, le chant classique a inspiré de nombreux compositeurs qui lui ont dédié divers genres musicaux : chansons polyphoniques, messes, motets, chorals, cantates, opéras, oratorios, mélodies, etc.
- Dans la musique traditionnelle, le chant sert de support à un court texte plus ou moins poétique pour former une chanson.
La tessiture
En musique, la tessiture d’une voix ou d’un instrument désigne l’ensemble des notes qu’un musicien, chanteur ou instrumentiste, est capable d’émettre facilement, depuis le grave, jusqu’à l’aigu. La tessiture et le timbre servent à classer les voix et certains instruments par catégories ou familles.
La tessiture fait donc référence au registre (caractéristiques sonores et techniques) que le chanteur peut interpréter aisément. Dans le chant il y a principalement trois registres : la voix de poitrine, la voix de gorge et la voix de tête.
Cliquer sur l’image ci-dessous pour plus de détails !
Le mot » tessiture » doit être soigneusement distingué du mot ambitus, qui lui, désigne l’intervalle total (entre les notes extrêmes) d’une partie musicale (d’une voix ou d’un instrument) et fait référence à la hauteur (aigu, moyen, grave).
La production
La production de la voix n’est pas très différente de la production du son avec des instruments de musique. Entre notre bouche et nos poumons, nous avons tout le nécessaire pour créer des sons riches et variés.
La première étape pour la production d’un son est la création d’un excès de pression dans les poumons. Ils vont expulser de l’air en passant par les cordes vocales qui, de ce fait, vont se mettre à vibrer. Le larynx, le pharynx, la bouche et le nez ont le même rôle qu’une caisse de résonance chez les instruments : ils amplifient les sons et les rendent audibles.
Attention : On a seulement deux cordes vocales. Ce sont des ligaments qui ne ressemblent en rien aux cordes instrumentales.
On obtient des sons plus ou moins graves :
-
-
- selon la tension des cordes vocales : plus la tension des cordes vocales est élevée, plus la note produite est aigüe
- selon la forme que prennent les cavités de résonance : ces cavités sont la bouche, la gorge (larynx et pharynx) et le sinus.
-
On modifie la tension des cordes vocales et la forme des cavités de façon naturelle, sans nous en rendre vraiment compte.
Par contre, les chanteurs d’opéra possèdent une connaissance approfondie des techniques qui permettent une bonne production de la voix comme :
-
-
- la respiration
- le souffle
- l’utilisation de la cavité nasale
- les résonances de poitrine et de tête
-